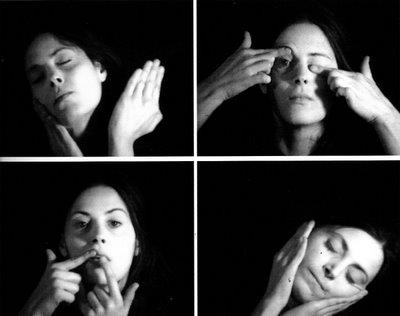La fin du monde a déjà eu lieu alors tes prédictions apocalyptiques à la con, ça ne risque pas de me faire peur.Il ne s’agit pas simplement d’une rupture, d’un bouleversement, d’une perte de repères.Non rien d’un truc déchirant qui transperce, puis s’essouffle à la longue et toi lentement tu cicatrises, autour le monde reprend forme et tout ou presque redevient vivable.Il ne s’agit pas d’un avant ou d’un après, mais d’un temps horizontal, presque létal, sans tension ni risque de chute.Il ne s’agit pas d’une terre qui a tremblé trop fort, dont les murs se sont fissurés avant de tomber mais d’un continent immense et pourtant totalement englouti.Il s’agit d’un monde perdu, disparu, d’une civilisation dont les feux se sont éteints d’un seul souffle, dont j’ai oublié la langue et ses idiomatiques.Il s’agit de quelque chose qu’on ne rejoindra plus.Il nous faudrait des siècles pour émerger, reconstruire, ressembler au réel, et si le temps me manque, l’idée me déplaît.Depuis je me tais, j’ai perdu ce langage, son sens, sa signification, sa materialité physique comme sa dimension mystique.On l’a trop effeuillé, décliné, retourné dans tous les sens, toi et moi.Peut-être que ça n’existe pas, peut-être qu’on se raconte tous des histoires aveuglément sinon ça n’est pas supportable.Tous ces êtres débordants de sentiments qui tentent de se rejoindre puis immanquablement se dégonflent, s’éloignent et redeviennent poussière.Peut-être que j’aimerais bien au fond retrouver la saveur et mordre à même la chair, peut-être que je m’y refuse, que j’irais trop loin cette fois, qu’on ne pourrait plus m’arrêter.En fait je n’en sais rien puisque rien ne vient, alors tu vois je m’en fiche, je m’en contrefous même, la douleur et moi on se connait maintenant, on s’est apprivoisé, du coup on s’ignore, on se tient à distance sans se perdre de vue.Quelquefois je fais semblant, je mime, le plaisir c’est encore assez facile et le goût du jeu d’enfant subsiste.Pas trop longtemps sinon ça ne tient pas, la mise en scène est minimaliste, le décor fantômatique et comme je ne connais pas mon texte, je m’emmerde très vite et quitte lâchement les lieux.Je ne peux que tourner autour des mots, ceux qui parlent de ça, vides, flétris, désincarnés, ils ne pèsent rien, ne valent pas mieux.Je ne peux pas les nommer et pour ne pas qu’ils m’encombrent, je les recueille dans une grande enveloppe marron, sans charme.Après la déflagration j’ai cherché à leur faire la peau, m’y suis cassé les dents, ne sais comment ni par quel bout m’y prendre, d’un coup sec, d’un coup violent, ce serait plus humain.Je ne me noie pas même si tout est devenu flou, je me souviens mais ne fixe rien, je m’arrange avec ça, les choses me filent entre les doigts, se perdent dans le silence parce-que je ne veux plus rien saisir.
-

Toutes ces filles qui vivent dans mon corps by Céline Renoux is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 France License.
Based on a work at https://lafilledesastres.com/.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://lafilledesastres.com/. -
Rejoignez les 167 autres abonnés
Commentaires récents

Anonyme dans la fleur arachnéenne 
Pete dans la vague 
chailonick dans Le sourire de Lucien Gins… 
lafilledesastres dans #poemedeloin #poemfromafar 
Murièle Modély dans #poemedeloin #poemfromafar 
lafilledesastres dans Un flash, un slogan, trois poi… 
lafilledesastres dans 24 août 177 degrés Sud 
actualsculpture P. P… dans Un flash, un slogan, trois poi… 
actualsculpture P. P… dans 24 août 177 degrés Sud 
mulmo dans 24 août 177 degrés Sud 
lafilledesastres dans Plus loin les Appalaches 
lafilledesastres dans Le problème avec les viva… 
actualsculpture P. P… dans Le problème avec les viva… 
actualsculpture P. P… dans Plus loin les Appalaches 
lafilledesastres dans Le problème avec les viva…